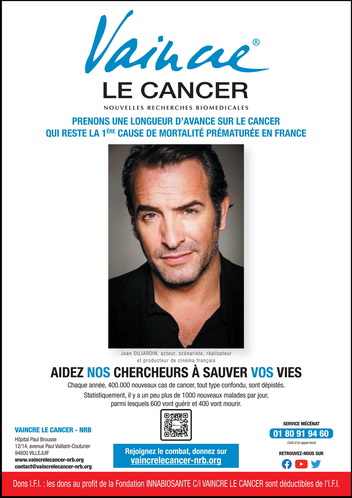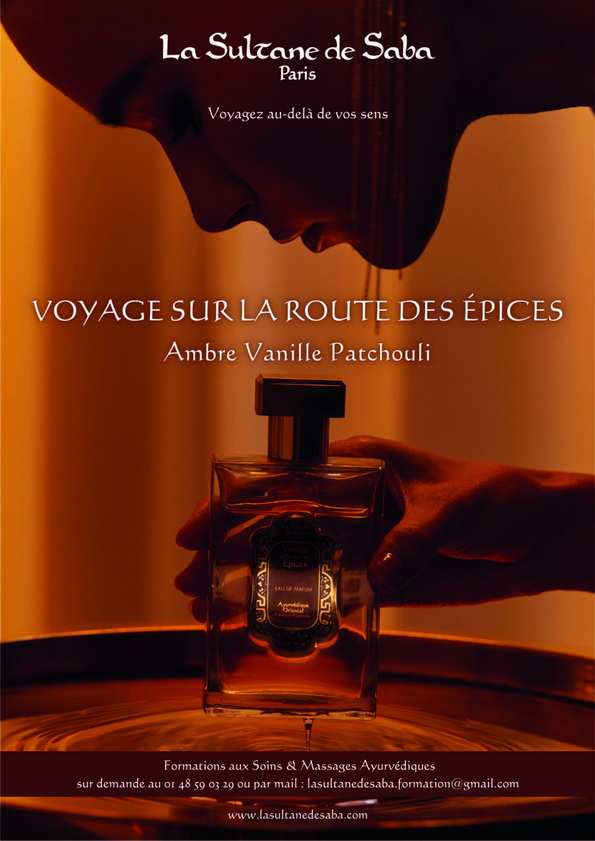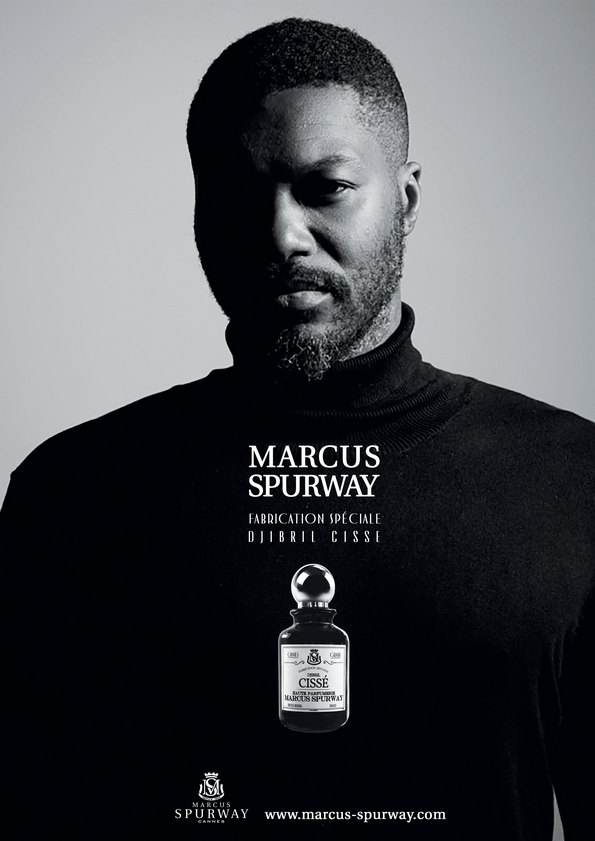Rencontre
Sébastien Gréaux, directeur de l’ATE : « Créer une réserve terrestre à Saint-Barthélémy »

Fondée en 2013, l’Agence Territoriale de l’Environnement de Saint-Barthélémy mène des actions de protection de la nature, aussi bien sur le plan maritime que terrestre. Sébastien Gréaux, directeur de l’ATE depuis 2019, nous explique les différentes missions qu’il mène avec son équipe pour protéger et recréer les richesses naturelles de l’île, tout en préservant la qualité de vie des habitants.
-Quel est le domaine de compétences de l’ATE ?
Au départ, l’ATE est un établissement public sous tutelle de la collectivité. C’est lorsque Saint-Barthélémy est devenue collectivité territoriale, que l’ATE a été créée en 2013 pour mettre en œuvre une vraie politique environnementale. Le nombre de nos missions ne s’est plus limité à la seule gestion de la Réserve Naturelle, nous agissons depuis dans des domaines très variés. Ainsi, on attribue aussi bien des permis de pêche et de plaisance, que des aides pour l’installation de panneaux et de chauffe-eaux solaires, on gère la question des autorisations de défrichement, on réfléchit à des solutions pour agir contre les espèces exotiques envahissantes… Nos missions qui étaient presque exclusivement marines par le passé se sont élargies sur tout le territoire de Saint-Barthélémy et nous sommes désormais investis aussi de missions terrestres.
-Quelles ont été les actions les plus marquantes de l’ATE ces dernières années ?
Parmi les actions les plus marquantes au niveau terrestre, il y a la mise en place d’un programme d’actions pour réduire le nombre de chèvres en divagation sur l’île. Les chèvres représentent actuellement la plus grosse menace qui pèse sur notre environnement à Saint-Barth car elles sont des milliers à se promener dans la nature et il faut savoir qu’elles ingèrent 20 kg de végétaux par jour. Plusieurs espèces végétales ont déjà disparu de la surface de l’île du fait de ce surpâturage, et on observe une érosion dans certaines zones avec des eaux très chargées en particules qui se déversent dans les baies car il n’y a plus assez de végétation pour tenir la terre. Ainsi, certaines zones de récifs et d’herbiers marins se dégradent et s’envasent car la couverture végétale des terres à proximité a quasiment disparu à cause de ces chèvres.
-Votre action a-t-elle été couronnée de succès ?
C’est complexe car cela nous demande d’avoir l’autorisation des propriétaires pour intervenir sur le terrain. Mais on a quand même réussi à capturer 4000 chèvres en 5 ans, ce qui nous a permis de commencer à replanter des espèces indigènes dans certaines zones. Par ailleurs, depuis 4 ans, on a créé une pépinière où on compte plus de 400 plantes pour une centaine d’espèces indigènes. Notre but est de réussir à reproduire celles qui sont en forte régression sur l’île afin de sauver des espèces sur le point de disparaître du milieu naturel. Ceci va de paire avec notre action : lorsque les chèvres sont éradiquées de certaines zones, on s’applique à replanter rapidement pour que la végétation joue à nouveau son rôle au niveau du maintien des sols.
-Qu’en est-il de vos actions sur le plan maritime ?
Auparavant, nous avions la même réglementation de la pêche qu’en Guadeloupe et à Saint-Martin. Depuis 2015, Saint-Barthélémy a sa propre réglementation qui est bien plus restrictive, et on commence à en voir les effets positifs. Il existe par exemple une espèce de gastéropode, le Burgos, que les gens pouvaient par le passé pêcher toute l’année, mais on s’est aperçu, grâce à des études menées par des scientifiques, que les trois quarts des Burgos étaient pêchés pendant la période reproduction. Nous avons donc mis en place une interdiction de pêche pendant cette période et elle porte déjà ses fruits : grâce à cette mesure de protection, le rendement des pêcheurs est plus important aujourd’hui qu’avant sa mise en place.
-Quels sont les projets que vous aimeriez mettre en place dans le futur ?
Notre gros projet est de réussir à créer une réserve terrestre. Actuellement, la réserve est exclusivement marine. Nous allons proposer prochainement aux élus de créer une réserve terrestre qui inclurait tous nos îlots. Il existe 17 îlots qui entourent Saint-Barthélémy, et aucun n’est protégé. Pourtant, l’enjeu est important : ce sont des gros sites de reproduction, notamment pour les oiseaux marins. Ces îlots sont aussi de superbes terrains pour faire de la replantation de végétaux. Et notre objectif est d’aménager parallèlement des zones pour permettre aux gens de continuer à venir se promener et pique-niquer sans impacter ces ilots.
-Avez-vous des inquiétudes particulières en ce qui concerne l’environnement pour le futur ?
Oui. On est en train de faire face à une disparition très rapide des coraux, du fait de la hausse de la température de l’eau et du changement climatique. Ce constat est vrai pour l’ensemble des Caraïbes et pour une bonne partie des zones coralliennes dans le monde. Durant deux années de suite, des températures élevées ont engendré une mortalité de corail importante. Il faut que chacun ait conscience de ce qu’il se passe : la disparition des coraux n’aura pas que des conséquences sur les poissons qui en dépendent : elle en aura aussi sur nos modes de vie. On risque par exemple de n’avoir plus de protection en cas de houle ou de cyclone. L’enjeu est vraiment la sécurité et la survie des hommes, et pourtant cela fait des décennies que rien n’avance et qu’aucune décision n’est prise. Or, ce ne sont plus des prédictions : d’ici à 5 ans, il n’y aura plus de coraux. Il est temps de tirer la sonnette d’alarme et d’agir en urgence… Pour tenter d’inverser la tendance !